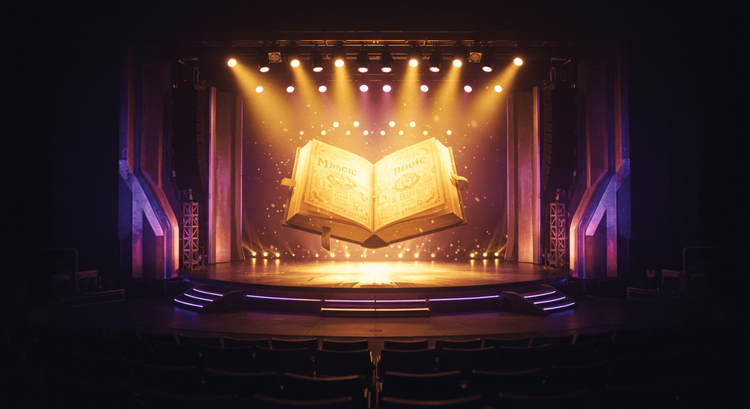Peut-être que, de cette période, commence le développement actif des méthodes et techniques d'utilisation de la lumière dans un spectacle comme élément expressif organisant le spectacle théâtral, l'application des techniques de direction d'éclairage. Au début, le développement des bases de la direction d'éclairage était principalement théorique, puisque sa mise en œuvre complète n'était pas permise par le faible niveau d'équipement technique des théâtres.
La correspondance de la conception du spectacle avec le développement émotionnel de l'action dramatique a commencé à être considérée au début du XXe siècle. "La décoration doit attirer l'attention du spectateur non pas comme une image brillante existante en soi, mais au moment de l'action, il doit, sans s'en rendre compte, ressentir l'impression de l'image dans laquelle l'action se déroule."
Par la suite, avec le développement de la technologie théâtrale, les prémisses théoriques ont trouvé de plus en plus d'opportunités de mise en œuvre dans la pratique théâtrale.
Le fondement théorique de la direction d'éclairage a été posé dans les œuvres du grand réformateur de la scène, Gordon Craig. Les premières performances musicales de Craig ont donné un puissant élan à d'autres recherches et expériences par une grande cohorte de metteurs en scène européens. "Dans les premières œuvres de Craig, une nouvelle manière de créer la forme scénique est apparue pour la première fois : la forme surgissait entièrement sans l'utilisation de décorations sous leur forme précédente — par la force du seul jeu expressif des rideaux de lumière changeants. Un nouveau principe de construction de la structure du spectacle a émergé."
Le génie de Craig est si prémonitoire, ses découvertes dans le développement des techniques scénographiques et des solutions pour des performances entières, notamment pour le répertoire de Shakespeare, sont si grandes que même aujourd'hui, dans les œuvres des metteurs en scène, des citations entières des œuvres de Craig apparaissent, et leurs créateurs peuvent même ne pas savoir qu'ils citent Craig.
A. Y. Taïrov développe le problème des "déplacements dynamiques," "... naissant non pas en raison d'une ou d'une autre modification visuelle, mais en raison d'une saturation émotionnelle extrême, aspirant inévitablement à une résolution dynamique." Dès la première performance "Sakuntala," le désir de créer "une image synthétique particulière du texte de Kalidasa" conduit à l'utilisation des principes du théâtre indien, où "Le problème des déplacements dynamiques que j'ai posé peut être résolu soit par un certain nombre d'adaptations techniques, soit par la participation active de la lumière dans l'action.
Le rôle de la lumière sur scène est sans aucun doute encore insuffisamment apprécié par nous, et les esprits qui s'y cachent ne sont toujours pas extraits des lampes électriques hermétiquement scellées."
Un événement significatif dans le travail de Taïrov fut sa rencontre avec A. Salzmann. Au début du XXe siècle, travaillant dans la salle de théâtre éducative de l'Institut du Rythme à Hellerau, A. Salzmann (un artiste de théâtre, "ingénieur lumière") utilisait une technique de mise en scène non conventionnelle : il équilibriait la scène et l'auditorium avec une lumière diffuse, mettant ainsi en valeur l'action, l'intensité du son et la plasticité des acteurs. "La lumière diffuse — la lumière du jour sans le soleil — renforce les nuances de couleurs et donne une puissance expressive aux contours eux-mêmes."
"La dynamique de la performance était assurée par la direction d'éclairage de A. Salzmann : les panneaux lumineux encadrant l'espace de jeu, parfois opaques, parfois transparents, créaient une atmosphère irréelle ; des rayons colorés dirigés, en l'absence de sources lumineuses visibles, apparaissaient comme venus de nulle part. Les ondes lumineuses mouvantes, soumises à un rythme magique, enveloppaient les figures figées des acteurs dans un éclat ou les couvraient d'ombre — ainsi, des forces supérieures disposaient de leur vie et de leur mort. Le concept poétique de Claudel était ici incarné dans le symbolisme et le rythme de la lumière." Il convient de noter que Salzmann a travaillé sur cette performance en étroite collaboration avec Adolphe Appia.
Voici des témoignages de contemporains :
"Notre compatriote A. Salzmann, selon le projet duquel l'éclairage de la grande salle de Hellerau est réalisé, est occupé des décorations pour la production prochaine lors des célébrations scolaires de juillet du 'Orfeo' de Gluck. Et plus loin : la production de 'Orfeo' par Dalcroze... a ouvert la voie... à la seule forme d'art lyrique. Pas de décors : calicot gris et bleu sous forme de rideaux sur différents plans, descendant sur des escaliers, des marches et des plateformes recouvertes de tissu bleu foncé...
Une seule force, à part l'homme et la musique, participait à la performance — la lumière. Ceux qui ne l'ont pas vu ne peuvent imaginer ce que donne la participation de la lumière, ses crescendos et decrescendos dans les crescendos et decrescendos de la musique — la simultanéité et l'accord de la dynamique lumineuse avec le son.
... Mais lorsque la lumière s'atténue sur des scènes de malveillance humaine et de ténèbres spirituelles, lorsqu'elle grandit avec le 'crescendo' musical et se résout en éclat sur des scènes de victoire et de triomphe..." Dans les paroles des témoins, nous ressentons une telle intensité de plaisir esthétique éprouvé qu'elle ne peut qu'éveiller l'envie des participants à cette action théâtrale.
Dans cette même performance, la lumière a également "joué son rôle" au sens propre du terme. "L'une des applications les plus intéressantes de la lumière est le rôle de Cupidon. Cupidon était invisible ; au lieu du travestissement habituel avec des ailes et un carquois sur son dos, nous entendions chanter en coulisses, et sur scène, nous voyions une intensification de la lumière."
Le désir de créer un volume scénique capable de réaliser "une performance émotionnellement tragique se développant dans l'intégrité et la clôture de ses formes esthétiques et soumise aux lois de sa propre expressivité" était l'idée principale de A. Salzmann.
Avec le début de la Première Guerre mondiale, A. Salzmann a déménagé d'Autriche à Moscou, où il a participé activement à l'ouverture du Théâtre de Chambre de A. Taïrov. Leur travail commun a en grande partie déterminé l'unicité de la stylistique des premières performances de ce théâtre. A. Salzmann a continué à développer les idées initiées avec A. Appia à Hellerau.
La recherche de la création d'une performance émotionnellement tragique qui se développerait dans l'intégrité et la clôture de ses formes esthétiques et serait soumise aux lois de sa propre expressivité a conduit au drame lyrique. "L'élément émotionnel du drame lyrique de N. N. Annensky a été perçu comme un flot d'émotions d'un ordre théâtral." La conception lumineuse de "Phèdre" visait à créer une sorte de saturation tridimensionnelle, sphérique de l'atmosphère scénique avec du contenu coloré. "La peinture, en tant que moyen de traitement de la surface d'une construction ou d'une autre, a été déplacée par la lumière, saturant de son atmosphère colorée toute la structure de l'espace scénique... Le système ingénieux de Salzmann, plaçant des sources lumineuses derrière des horizons neutres et en plusieurs autres points, a permis de matérialiser de manière inhabituelle tout l'espace aérien de la scène et de le remplir de contenu coloré changeant, dans lequel toute l'atmosphère scénique s'immergeait." De cette manière, le problème de l'éclairage de l'espace scénique de l'extérieur a été éliminé, et la lumière est devenue un élément organique de l'atmosphère scénique.
"La boîte scénique, qui est presque un cercueil immuable pour beaucoup de recherches, s'est ouverte en muette impuissance devant les puissants flux de lumière saturant le modèle," se souvenait Taïrov. "Et maintenant les murs ont disparu, et l'atmosphère lumineuse se répandant changeait sa couleur, répondant à la moindre pression de la manette de commande."
"La lumière solaire et la lumière lunaire ne sont pas intéressantes en elles-mêmes ; elles nous intéressent uniquement comme forme élémentaire d'expérience émotionnelle." Ce paradoxe particulier de A. Salzmann pourrait probablement aussi appartenir à Taïrov.
La scénographie en tant qu'environnement communicationnel cherche la fusion du visible et de l'audible avec l'idée, le super-objectif, et les concepts de la performance. Le désir de passer des détails quotidiens à un niveau supérieur de communication émotionnelle mène au problème de la création d'un environnement objet communicationnel complexe sur scène.
L'environnement complexe doit, si nécessaire, être instantanément saturé d'un grand nombre de signaux, de repères spatio-temporels, de signes, symboles et images d'objets sémantiquement chargés qui rendent tangible ce qui est sujet à la perception directe. Il doit également se libérer rapidement de ceux-ci, se vider d'eux de manière opportune, prenant une apparence totalement neutre tout en maintenant une connexion interne et une unité figurative. Cependant, l'environnement ne doit pas agir comme un dictateur ou un souffleur ; la dynamique ne doit pas distraire mais au contraire, affiner la perception par le spectateur de l'action scénique, concentrant l'attention.
Il est essentiel d'avoir une correspondance idéale de la lumière avec le son et la plasticité de la performance, permettant à l'acteur d'interagir avec la lumière : ressentir l'illumination, entrer dans la lumière, résister ou céder à son mouvement. Un environnement lumineux mobile expressif est créé, subordonné à une solution scénique unifiée.